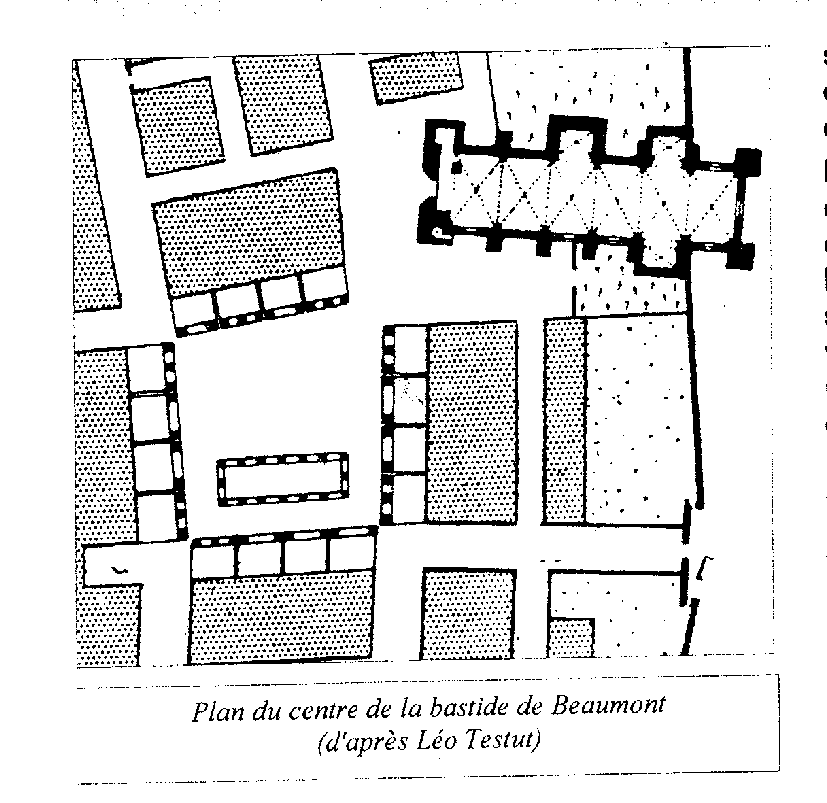-
Bastides bienvenue :
-
-
.
-
Villes Neuves
-
- en EUROPE
:
-
Présentation générale
-
France
-
Espagne
-
Grande Bretagne
-
Italie
-
Pologne
-
Portugal
-
Suisse
-
Scandinavie :
-Finlande
-
Norvège -
- .
- hors d'EUROPE,
-
Amérique
-
Afrique
-
Asie
- .
-
Bastides médiévales:
- 1-
tableau des "modèles"
- 2- ..Libourne.
..Monpazier..Monflanquin.
- ..Vianne..Villeneuve/Lot
- Bastides
Gironde.
- .
- *
-
Définition de "Bastide",
-
leurs caractéristiques,
-
leurs Chartes.
-
Le Tracé orthogonal,
-
la Place,
-
la Halle,
-
les Maisons,
-
les Cornières un problème,
-
les Andrones,
-
L'église
-
les Remparts : avec ou sans.
-
Chateau : avec ou sans
-
Puits et ponts
-
Bastides Modèles.
-
Contexte historique.
- .
-
Présentation par :
-
Cartographie
-
Musée des Bastides,
-
Centre Etude Bastides,
-
Bibliographie,
-
Glossaire,
-
Toponymie
- .
-
Bastides Répertoire
-
par fondateurs:
-
Cisterciens
-
par départements,
-
sur sites internet
-
par bastides :
-
A à M
-
N
à V
-
par Thèmes
- .
-
L'orthogonalité :
- dans l'Antiquité,
-
dans la théorie.
- dans les arts
-
- *
-
Annexes sur :
-
les villes en étoile,
-
les "circulades",
-
Sauvetés et castelnaus
-
-
**
-
Recherche d'une vue aérienne
-
de ville sur "google earth"
-
-
-
Recherche : Interreg
-
Université de Tokyo
|
|
|
Odo Georges |
|
Site traduit en : |
|
|
|
- .

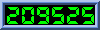
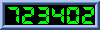
- Plan orthogonal, en damier,
hyppodamien
| |
Beaumont
Plan en H ????
- La création de la
bastide de Beaumont du Périgord est étroitement mêlée aux décisions
administratives et diplomatiques ainsi qu'aux manuvres et opérations
militaires, prises ou entreprises en Gascogne (ce mot étant pris au
sens du XIII° siècle
où Aquitaine, Guienne et Gascogne étaient synonymes, et non au sens
étroit qu'il a de nos jours) par le roi-duc Henri III ou son fils, le
prince Édouard.
-
- Henri III
avait envisagé très tôt pour son fils un mariage du côté espagnol
et, dans le souci de lui préparer des revenus suffisants pour un
train en rapport avec. son état, lui avait fait quelques donations
dont celle, qui n'est pas la moindre, du duché aquitain.
-
- Comme
Alfonse X de Castille faisait valoir, à plus ou moins juste
titre, quelques prétentions sur le duché, Henri III chercha à se
l'attacher ou à le mettre dans son camp, en projetant le mariage d'Édouard
avec la sur du roi de Castille, Aliénor.
- Ce
mariage eut lieu près de Burgos, au monastère Santa Maria la Real,
le 1er novembre 1254. A l'âge de 15 ans, le prince Édouard allait
donc "gouverner" la Gascogne, usant d'une indépendance
assez théorique car c'est le roi qui en fait contrôlait les décisions
et les mesures importantes prises, sous l'il d'Alfonse X qui
veillait au strict respect des clauses du traité conclu à l'occasion
du mariage de sa sur. A ces contraintes près, le prince Édouard
administra son duché avec efficacité
et intelligence, en dépit de quelques maladresses à mettre sur le
compte de sa jeunesse.
- Les
relations entre le roi-duc et le prince connurent bien des moments
difficiles qui parvinrent à leur paroxysme vers 1258, sous forme d'un
véritable conflit. Il éclata quand Édouard, pour pourvoir au
remplacement du sénéchal Etienne Longuépée, qu'il avait nommé en
1255 sur l'avis de son père, voulant cette fois s'en dispenser,
nomma, en juin 1258, comme sénéchal de Gascogne, son oncle Geoffroi
de Lusignan. Henri III s'opposa à cette nomination, alla jusqu'à
contraindre son fils à révoquer Geoffroi (ce qu'il fit le 12 juillet
suivant), puis nomma, dans le courant de 1259, Dreu de Barentin (1).
- Dix
ans passent au cours desquels le prince agit dans l'ombre de son père.
Au début des années 70, Saint-Louis meurt devant Tunis, le
prince Édouard est en Terre Sainte où il participe au siège d'Acre,
Philippe III succède à son père sur le trône de France et,
au printemps 1272, s'apprête à engager les hostilités contre le
comte de Foix.
- C'est
alors la panique à Londres où l'on craint pour le duché en
l'absence de son prince et au moment où la santé du roi-duc
chancelle. On nomme alors à la tête du duché deux hommes sûrs et
efficaces: Luc de Thanet comme sénéchal, Thomas de Clare comme
lieutenant (2).
- Le sénéchal de
Gascogne est le personnage de loin le plus important dans
l'administration du duché. Quand le duc est absent - et le duc, ne
l'oublions pas, est aussi roi d'Angleterre - il l'y représente et, écrit
Trabut-Cussac (3) : "puisque son autorité est une émanation
de l'autorité ducale, son pouvoir un fragment du pouvoir ducal, on
conçoit que le choix du sénéchal, sa nomination, sa rémunération
relèvent du souverain, et de lui seul [. ..]. Ni Henri III ni
Édouard 1 ne s'en sont volontiers remis à autrui du choix de
leurs sénéchaux.". Le plus souvent, il était choisi parmi
des personnages n'ayant pas encore eu d'activité dans le pays. Luc de
Thanet est l'une des exceptions. Avant de se rendre en Gascogne, il
avait été connétable du château royal de Knaresborough. En 1272 il
était clerc, chapelain du pape. Familier et fidèle du prince qui
l'appréciait hautement, il fut nommé par Henri III lui-même, tant
en son nom qu'au nom de son fils absent, le 18 mai 1272 (il sera révoqué
en mai, juin ou juillet 1278, à une date que l'on ne connaît pas
avec précision, pour "conduite tapageuse"(4) des affaires
aquitaines).
- Henri
III s'éteignit le 16 novembre 1272. La nouvelle de sa mort ne parvint
pas à son fils avant le début de l'année suivante, alors qu'il
revenait de la croisade. Cette nouvelle ne lui fit pas hâter le pas:
de Sicile où il était le 16 janvier, il se rendit à Paris où il
arriva le 27 juillet, mettant' plus de six mois pour parcourir la
distance (5). Il était désormais roi d'Angleterre et duc d'Aquitaine
sous le nom d'Édouard 1er.
- Faisons
nôtre l'opinion générale : la bastide de Beaumont fut construite
sur ordre de Luc de Thanet. La décision fut prise après mai 1272.
Faisons nôtre aussi l'affirmation de Léo Testut selon qui la
transaction qui mit fin au conflit qui opposait l'abbé de Cadouin au
prieur de St-Avit-Sénieur (ils prétendaient tous deux être propriétaires
du terrain) fut signée en novembre 1272 alors que le plan de la
bastide était déjà tracé et que les lots étaient attribués (6).
- Nous
en concluons que la décision de construire une bastide à Beaumont
fut prise avant novembre sous le sénéchalat de Luc de Thanet et sur
l'ordre du roi, à une date où, depuis deux ans, le
prince absent ferraillait chez les infidèles à l'autre bout de la Méditerranée.
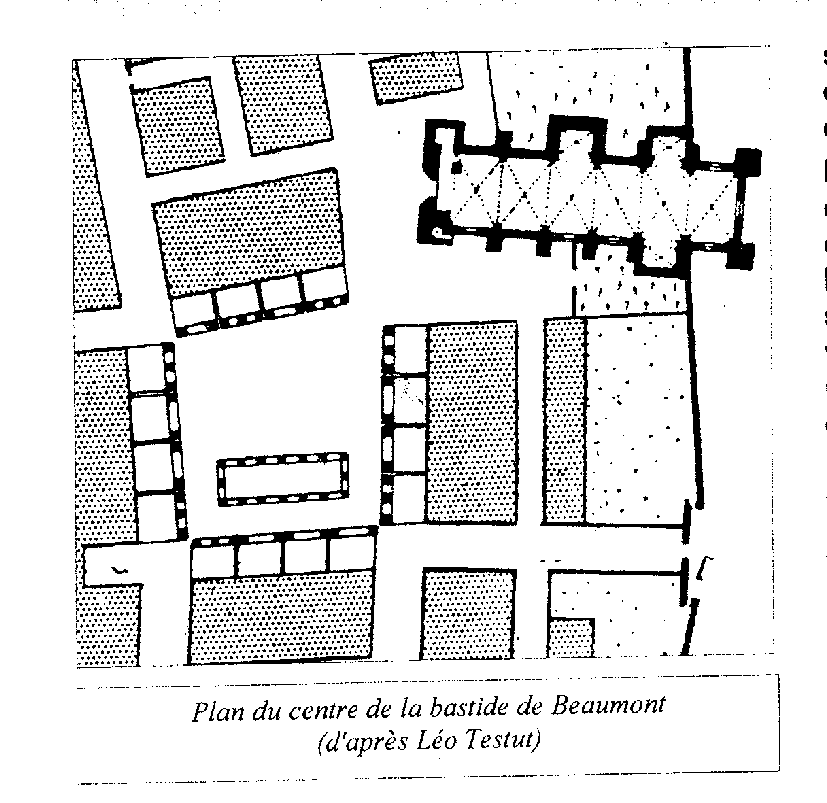
-
- On
voit mal dès lors comment on pourrait, par des raisons historiques sérieuses,
expliquer la soi-disant forme en H du plan de Beaumont (la date de sa
conception, la nature conflictuelle des rapports du père et du fils
et, purement et simplement, la géométrie s'y opposeraient).
D'ailleurs, pour trouver la lettre H dans un tel plan, il faut déjà
y voir très mal.
- La
place centrale, élément qui, par sa
situation, commande
la géométrie de l'ensemble de la bastide, est un quadrilatère on ne
peut plus irrégulier on y cherche en vain un angle droit et deux côtés
égaux - à
l'extérieur duquel, dans l'angle nord-est, on
a implanté l'église selon un axe qui
paraît aléatoire. Aléatoire? Non pas!
- Les
géomètres et les arpenteurs qui ont tracé le plan des rues et des
places, délimité les lots, ont utilisé le terrain, qui n'admettait pas l'impérialisme de l'angle droit, avec infiniment
d'intelligence et d'habileté. Il suffit de comparer à Monpazier où
l'on ne voit que des parallèles et des perpendiculaires engendrant à la longue une grande monotonie qui a
fort heureusement été évitée à Beaumont.
- Bref, si dans un atlas de plans de bastides(7) , il en existe, on
commençait par éliminer celles dont la forme diffère d'un H,
Beaumont serait une des premières écartées. On peut d'autre part,
pour des raisons qui tiennent à leurs rapports, ne pas être très sûrs
que le prince Édouard tenait tellement à rendre hommage à son père.
On serait même plutôt tenté de penser que la mort de son père, si
elle l'a
attristé, l'a aussi soulagé d'une tutelle pesante
et paralysante, lui accordant enfin la liberté d'action à laquelle
il aspirait depuis la donation du duché.
Mais qui donc est à l'origine de l'explication ridicule et grotesque
par la lettre H qu'aucun document écrit de l'époque n'atteste? On peut
craindre, pour l'honneur des beaumontois, que la paternité, et il
serait plus approprié de dire ici la maternité, en revienne à une
beaumontoise qui avance il y a peu :"Il voulut [le
prince Édouard, et le mot prince, et non roi, n'est pas ici écrit
innocemment] aussi que son plan soit différent de celui des autres
bastides [cela est vrai! Toutes les autres bastides ayant la forme
d'un H, Beaumont ne l'aura pas] et lui donna la forme d'un H [nous
y voilà !] en mémoire de son père Henri III mort avant le
commencement des travaux." (8). La dernière affirmation est
d'ailleurs aussi fausse que tout le reste puisque le plan et
l'attribution de lots étant antérieurs à la mort d'Henri III, la
forme de la bastide ne pouvait être liée à la mort de ce dernier
(voir L. Testut cité plus haut).
Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Or,
en 2003, au moment où ces lignes sont écrites le diable est toujours debout. Un exemple suffira le prouver, mais on
pourrait en citer bien d'autres Dans un guide, à la disposition de
milliers de touristes, imprimé en 2003 sous l'égide du Conseil Général
de la Dordogne, on peut encore lire page 16 :"[...] Beaumont du
Périgord, dont le plan en H rend hommage au roi Henri III
d'Angleterre [...]". CONSTERNANT!
(1) J.P. Trabut-Cussac - "L'Administration anglaise en Gascogne
sous Henri III et Édouard 1 de 1254 à 1307" - Droz - Paris,
Genève - 1972 -
p. : 16 et 17.
(2) J.P. Trabut-Cussac - op. cit. - p. : 141 et suiv.
(3) J.P. Trabut-Cussac - op. cît. - p. : 40 et note 237.
(4) J.P. Trabut-Cussac - op. cit. -
p. : 57
(5) J.P. Trabut-Cussac - op. cit. -
p. : 41..
(6) Léo Testut - "La Bastide de Beaumont" tome 1 - p. : 62
et 63.
(7) Par exemple: Alain Lauret, Raymond Malebranche et Gilles Séraphin
- "Bastides. Villes nouvelles du Moyen Âge" - Éd. Milan -
1988.
(8) Guide touristique MAIF - Périgord/Quercy 1970 - p. : 458.
Jean Darriné Juillet 2003
|
| Extrait
du Bulletin de Beaumont 2003 nov. |
|